
Un roman qui guerrit au contact de la beauté et de la force de la nature.
Les Femmes du bout du monde est le premier roman de Mélissa Da Costa que je lis. Intriguée par le fait qu’elle soit l’autrice française la plus lue, je n’ai pas pu résister à la curiosité ! La localisation de son histoire, sur un bout du monde venteux, a fait le reste.
Un voyage intérieur
Flore, trentenaire parisienne, débarque comme une épave avec son sac à dos à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande après avoir répondu à une annonce de woofing. Elle s’installe comme petite main sur un camping pour surfers et s’abrutit dans le travail intense d’entretien. Elle y côtoie les propriétaires. Automn, rude, froide et distante, à l’abri des gens et du monde dans son mutisme, et sa fille de 23 ans. Milly, amoureuse de la nature, est pleine de vie et de rêves qu’elle semble résignée à abandonner pour aider sa mère. L’amour pour leur baie et pour les animaux qui la peuplent est contagieux, et panse peu à peu les blessures de l’âme.
« Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te le dire : nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C’est ce que font les femmes du bout du monde… »
P.337

En outre, ce roman repose que l’idée salvatrice qu’existe pour chaque être, quelles que soient ses fautes passées et ses culpabiblités, une rédemption laïque possible. Pour cela, il faut trouver le bon lieu et les bons compagnons de route.
« -Je ne me sens à ma place nulle part.
-Tu te sentiras à ta place le jour où tu auras trouvé le bon endroit. »
Une ode à la nature sauvage
Découvrir la Nouvelle-Zélande avec Mélissa Da Costa, c’est prendre le temps des saisons, être cinglé par les bourrasques du bout du monde, se laisser dorer la rétine par le soleil d’hiver et attendre les dauphins, les yeux rivés sur l’horizon.

« C’est en gravissant les derniers mètres d’une côte que l’image se révèle tout à coup à elles : un cliché de carte postale. Sur un ciel orangé baigné par les premiers rayons du soleil se dessine un promontoire escarpé qui s’avance en saillie vers la mer, avec à sa pointe un phare. Un phare blanc, majestueux, coiffé de noir. Autour du cap, sortant des flots turquoise, jaillissent une multitude d’îlots rocheux : les Nuggets – « pépites en anglais ». »
p.235
De plus, l’exil volontaire de Flore au bout du monde nous permet de découvrir des sites remarquables comme la forêt pétrifiée de Curio Bay ou le bout du monde à Slope Point. La jeune parisienne renaît à la vie au contact de la nature demeurée sauvage, et enchantée des légendes maories.

(…) le chemin s’ouvre soudain devant elles, la vue se dégage et se dessine alors une petite plage enclavée, à l’abri du reste de la baie. Pas de sable fin ici. La plage est faite d’une roche gris-noir. La marée est basse, l’eau s’est retirée en formant des bassins dans des cavités rocheuses.
p.122

Les descriptions des pinguoins aux yeux jaunes, les hoihos, à « l’heure dorée », la danse des dauphins-hector et le chant des baleines nous emplissent en même temps qu’ils soignent l’héroïne de ses démons.
La sagesse maorie comme supplément d’âme ?
Mélissa Da Costa nous propose presque une nouvelle version du mythe du bon sauvage (Rousseau), nous rappelant le pouvoir de la nature sur les humains. En effet, les légendes maories distillées au fil du roman replacent les hommes au milieu de la nature sur un pied d’égalité avec les éléments et les animaux.
« Nous faisons tous partie d’une seule et même grande famille. Les hommes sont les enfants de la terre et du ciel et les cousins de chaque être vivant. »
Le tour de force de l’autrice est de faire passer ce genre de poncifs pour crédibles grâce à l’expérience que vit Flore.
De plus, les légendes maories racontées par le vieil Anaru viennent égailler le roman, et le matinent de mysticisme.
« Kurawaka »
A cet endroit se trouve la terre rouge dans laquelle pourrait être créé le corps de la première femme. La fratrie s’unit alors dans cette oeuvre. Les plus grands modelèrent les formes, les plus jeunes apportèrent les os, la chair, la graisse, le sang, les muscles. TaneMahuta, le dieu des Forêts et des Oiseaux, insuffla la vie à cette première femme grâce à un hongi. Ansi naquit HineAhuOne, qui signifie « fille formée par la terre ». »
p.404
Ces parties ne sont pourtant pas les plus réussies. En effet, les légendes rapportées par les personnages au style indirect font penser à de la vulgarisation facile. Certaines sont âpres car complexes à démêler au milieu des dieux maoris, d’autres simplistes.
Ainsi, la plus-value n’est pas toujours au rendez-vous, peut-être à cause des choix des légendes. Les histoires maories paraissent parfois posées là comme prétexte à faire participer le peuple indigène de ce territoire au roman.

L’écriture de Mélissa Da Costa est simple et efficace. Les descriptions sont belles, précises et riches. Si l’histoire m’a intéressée, elle ne m’a pas transportée outre mesure. Pourtant, on passe un moment agréable à lire ce roman, à imaginer le bout du monde.
Le roman a le mérite de donner envie de visiter cette partie du globe. La relation qui se tisse entre les protagonistes principales est amenée avec douceur au fil des chapitres. Même si la fin est prévisible, on en apprécie la lecture jusqu’au bout. Enfin, le roman permet de se faire une idée claire de la vie dans ce bout du monde, particulièrement en basse saison, lorsque les back-packers et surfers désertent.



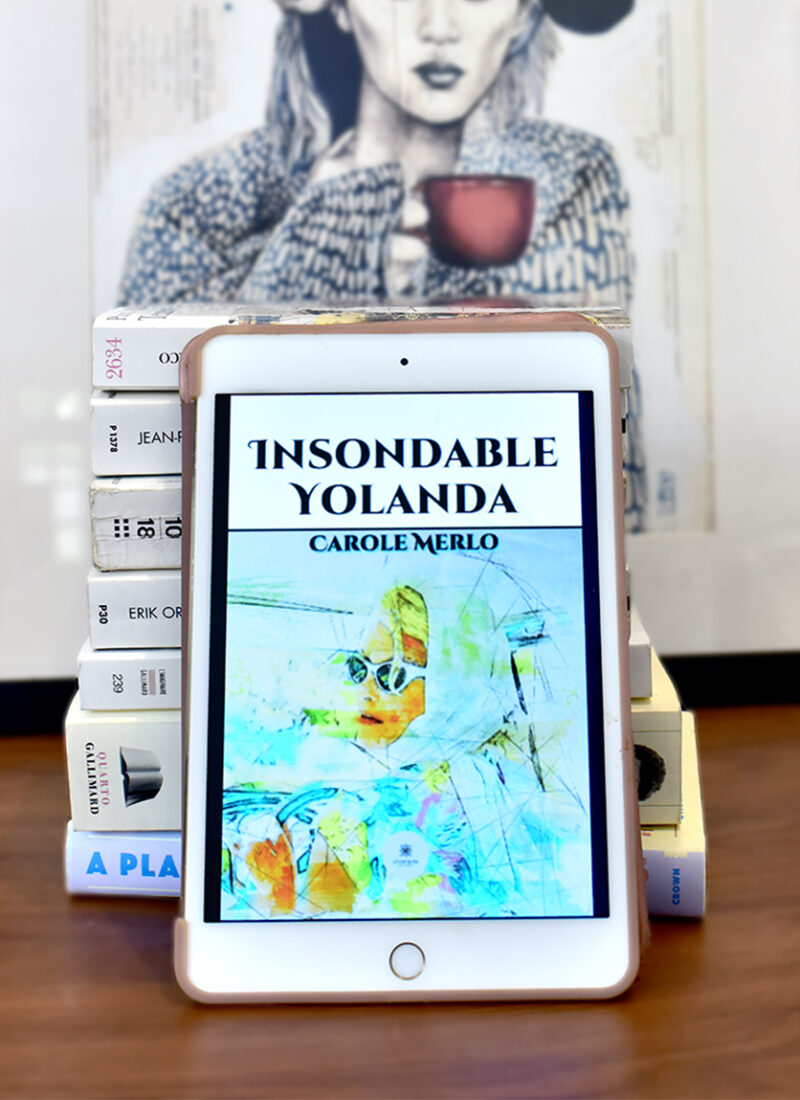
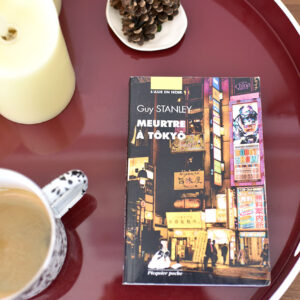
Laisser un commentaire